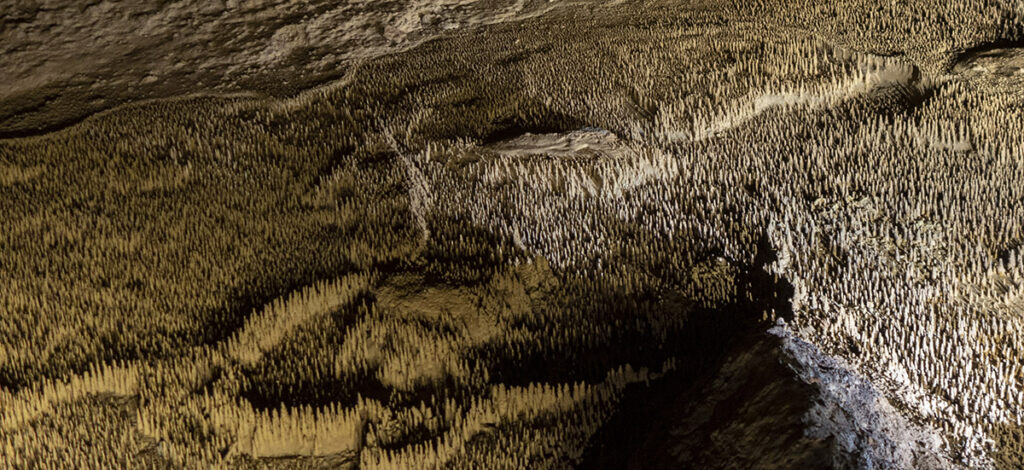Partons à la découverte de Montpellier, une ville dynamique et vivante! Cette balade dans le centre-historique est une invitation à explorer les incontournables de la ville, entre patrimoine, art de vivre et douceur méditerranéenne. C’est part, hop en route! 🙂
La petite histoire de Montpellier
Comme j’aime bien l’histoire, je vous fais un petit résumé de celle de Montpellier. Rassurez-vous, ça va aller vite 😉 La cité prend naissance en l’an 985 avec la création d’une place fortifiée. Rapidement, elle devient une grande ville marchande grâce à sa position privilégiée pour le commerce entre l’Espagne, la Méditerranée et le nord de la France. Sa prospérité au moyen-âge s’accompagne de la création d’une des plus vieilles universités de médecine d’Europe. L’âge d’or prend fin avec l’arrivée de l’épidémie de peste qui décime la ville à la fin du XIVe siècle. Alors que la ville reprend son essor, les guerres de religions entre Protestants et Chrétiens réduisent de nombreux quartiers en cendres. Après la reconquête et le retour de l’ordre royal au XVIIe siècle, la noblesse fait construire de nombreux hôtels particuliers et des jardins. La ville devient un véritable centre culturel qui rayonne dans le sud de la France. Après la Seconde Guerre mondiale, c’est le boum économique et la population qui augmente fortement, suite à une immigration de pieds-noirs et d’habitants des pays du Maghreb. La ville de Montpellier rime avec dynamisme, jeunesse (les étudiants représentent 20% de la population ) et élégance. Plusieurs villes dans le monde se nomment Montpellier justement en hommage à cette réputation de « belle ville » 😉
Allons voir ça d’un peu plus près!
Balade dans l’Ecusson
Pour découvrir cette jolie ville je vous propose une balade dans le centre historique de Montpellier, surnommé l’Ecusson. Il porte ce nom car si on regarde sur un plan, les contours de l’ancienne ville historique ressemblent à un écusson médiéval. Pour cette grande balade en boucle, nous partirons de la gare de Montpellier Saint-Roch, au sud du centre ville. Face à la gare, c’est le grand carrefour des rails du tramway. Même s’il y a le Square Planchon, on ne s’y attarde pas trop car depuis quelques temps, c’est devenu un coin mal fréquenté (surtout le soir).

Alors hop en route, on remonte la grande rue Maguelone pour s’enfoncer dans le centre. La ville a été construite sur deux collines, alors il y aura un peu de reliefs dans quelques rues. On remarque aussi rapidement la couleur blanc crème des bâtiments de Montpellier. La pierre de Castries utilisée dans de nombreuses constructions donne une couleur typique à la ville 🙂
La Place de la Comédie
On arrive sur la jolie Place de la Comédie 🙂 C’est un peu la grande place centrale du centre ville de Montpellier. Toute en longueur, elle doit son nom à l’Opéra Comédie, un grand théâtre a l’italienne, avec une grande salle de 1200 places, inauguré en 1888 (à l’emplacement de l’ancien théâtre détruit par un incendie). Il est classé monument historique.

Au centre de la place trône la Fontaine des Trois Grâces (1790). C’est le point de rendez-vous par excellence avant de partir en promenade, ou pour faire du shopping avec les nombreuses enseignes autour de la place. Il y a aussi plein de terrasses de restaurants et de bars. C’est un bel endroit où se poser et profiter du beau temps 🙂
L’Esplanade Charles de Gaulle
La Place de la Comédie se prolonge sur l’Esplanade Charles de Gaulle. Ces deux ensembles réunis forment un des plus grands espaces piétons de France. Cette esplanade date du XVIIe siècle, quand Louis XIII fait détruire d’anciens remparts pour laisser une ouverture aux canons de sa citadelle, afin de mater toute nouvelle tentative de rébellion protestante dans la ville. L’esplanade longue de 500m est un joli lieu de promenade paysager, bordé de grands platanes. Il y a toujours de l’animation et une bonne ambiance 🙂


Bordant l’esplanade, il y a le joli petit parc du Jardin du Champ-de-Mars. De l’autre côté de ce jardin, c’est le grand Lycée Joffre. C’est un des plus anciens lycées de France, dans l’enceinte de l’ancienne citadelle de Montpellier. Le long de l’esplanade on peut aussi visiter le Musée Fabre. C’est le principal musée d’art de la ville. Pour la modique somme de 9 Eur vous pouvez découvrir les œuvres d’un des plus grands musées régionaux de France. Bon à savoir, l’accès aux collections permanentes est gratuit le premier dimanche du mois 😉 Plus d’infos sur ce site. Enfin, à l’extrémité de l’esplanade, il y a le Corum. C’est le grand espace d’exposition et évènementiel du centre ville. Pour suivre sa programmation, c’est sur ce site.
À travers les ruelles
On s’enfonce maintenant dans les vieilles ruelles médiévales de la ville. C’est coloré et vivant. Nos pas nous mènent au MO.CO. (Montpellier Contemporain). C’est un grand centre d’art contemporain, situé dans les anciens locaux de l’Université de Médecine. Bonus, les expos sont gratuites 🙂 Plus d’infos sur ce site. À l’intérieur on peut aussi profiter de la belle terrasse au calme du très bon Café de la Panacée dans un patio arboré.

Un peu plus loin, les ruelles nous conduisent devant l’escalier menant à la Place de la Canourgue. C’est la plus vielle place de Montpellier. C’est aussi la plus belle, la plus romantique et la plus élégante. Elle est entourée de beaux hôtels particuliers du XVIIe siècle. C’est le lieu idéal pour flâner au calme à l’ombre des arbres, déambuler au milieu de petits jardins aménager et se poser sur les terrasses accueillantes 🙂 Depuis la jolie Fontaine des Licornes, on distingue des grandes tours de pierres, c’est notre prochaine étape.
La Cathédrale Saint-Pierre
Nous voici devant la Cathédrale Saint-Pierre. Elle n’était tout d’abord que la simple petite église d’un monastère, avant de devenir une cathédrale en 1536. Pourtant, elle ressemble d’avantage à une forteresse avec ses quatre tours fortifiées et ses murs massifs. Elle possède aussi la particularité d’avoir un énorme porche en baldaquin soutenu par deux larges piliers. Elle a un petit air de Cathédrale d’Albi (même si Albi est bien plus grande et plus belle 😉 ) Elle est pillée et pratiquement détruite en 1561 pendant les Guerres de Religions quand les protestants arrivent à pénétrer à l’intérieur et massacrent les résistants. Une nouvelle cathédrale devait être reconstruite sur la place de la Canourgue juste à côté, mais Richelieu interdit ce projet et décide de conserver la cathédrale Saint-Pierre. Elle ne sera finalement vraiment reconstruite et agrandie qu’au XIXe siècle pour atteindre 100m de long.



À l’intérieur on peut admirer un grand orgue magnifique de 1778 qui fait sa renommée. La cathédrale se visite gratuitement. Il est même possible de grimper au sommet de la Tour Urbain V. Une fois les 200 marches franchies, on peut profiter d’une vue panoramique à 360° sur Montpellier. Des visites guidées ont lieu les après-midi (5 eur, se renseigner à l’office du tourisme).
Le Jardin des Plantes
Juste derrière la cathédrale, on peut découvrir le plus ancien jardin botanique de France! C’est l’œuvre de Pierre Richer de Belleval qui suit des cours de médecine à l’Université de Montpellier (on retrouve d’ailleurs une grande statue de ce personnage dans le jardin). En 1593, il arrive à rencontrer le roi Henri IV et lui parle de sa volonté de développer « la santé par les plantes ». Il le persuade ainsi de fonder un jardin botanique royal, à l’image de celui de Padoue en Italie. Rapidement le jardin prendra de l’ampleur et ne se limitera plus aux seules plantes médicinales. Après plus de quatre siècles d’existence, il s’étend maintenant sur 4.6 hectares et attire des milliers de visiteurs chaque année. Le Jardin des Plantes est classé monument historique et jardin remarquable. C’est vraiment un très bel endroit. L’entrée est gratuite, et vraiment pas besoin d’être un botaniste pour tomber sous le charme 🙂



C’est un véritable plaisir de s’y promener. Près de la Noria et des vestiges de l’ancien jardin détruit pendant les Guerres de Religions, on trouve un endroit insolite qui plaira aux amateurs de poésie. Selon la légende, c’est dans le Jardin des Plantes de Montpellier que le célèbre poète anglais du XVIIIe Edward Young aurait enterré secrètement sa fille Narcissa. Un squelette retrouvé plus tard par des jardiniers a suffit pour « officialiser » cette légende (et attirer ainsi d’avantages de visiteurs). Elle a désormais un véritable tombeau dans un mur du jardin.
La belle Allée Charles Martins longe une élégante orangerie achevée en 1806.

Derrière l’orangerie, c’est la « Montagne du Richer » qui marque la limite nord du jardin jusqu’au XIXe siècle. Dans un arboretum, on passe des arbustes méditerranéens, aux vénérables feuillus et à une exotique bambouseraie. Un voyage végétal en quelques pas 🙂


On arrive ensuite aux aménagements du XIXe siècle de Charles Martins, le directeur de l’époque. On y trouve un très agréable jardin anglais créé en 1860 avec ses vastes pelouses ornées de massifs de plantes. Il y a aussi le « marabout algérien », un ancien observatoire astronomique près du « lac au Nélumbos », une mare où s’épanouissent des lotus.


Un peu plus loin, c’est la grande serre Martins (1860) qui abrite une collection de « succulentes » venant de toutes les régions arides du monde.

Le jardin fait toujours parti de la Faculté de Médecine de Montpellier. Pour connaitre les différents évènements organisés et les ouvertures de la serre, plus d’infos sur ce site.
Je vous conseille absolument cette visite dans le poumon vert de la ville 🙂
Le Jardin de la Reine
Juste à côté du Jardin des Plantes, il y a un endroit peu connu et caché derrière des murs. Une petite entrée discrète permet d’y accéder depuis la Rue du Jardin de la Reine. On découvre un joli jardin historique. Ce terrain acheté par Richer en 1619 lui servait de parcelle d’expérimentation pour le grand Jardin des Plantes. Il porte le nom de Jardin de la Reine en référence à Marie de Montpellier, Reine d’Aragon de 1183 à 1213, qui avait un jardin à peu près à cet endroit.

Propriété de l’état, il était laissé à l’abandon depuis deux siècles. En 2013, il est mis en vente. Pour préserver ce patrimoine végétal historique, une forte mobilisation citoyenne a permis l’achat par la ville. Depuis, ce jardin est géré par une association. On peut le visiter gratuitement les samedis après-midi 🙂

C’est calme et agréable car il n’y a presque personne. On se promène entre le potager, le verger et le sous-bois. Le jardin garde une allure de nature spontanée, et on a vraiment l’impression de se promener à l’intérieur d’une petite forêt sauvage en plein centre ville historique 🙂 Retrouvez toutes les actualités du Jardin de la Reine sur ce site.
À quelques pas de ces jardins, les rues grimpent vers un des plus beaux endroits de Montpellier.
La Promenade du Peyrou
La Promenade du Peyrou, c’est un superbe ensemble architectural à l’ouest du centre historique. Au XVIIe siècle la ville prend la décision d’aménager le point culminant de Montpellier. L’ancien promontoire situé à 52m au dessus des champs et des vignes va être transformé en une vaste esplanade et place royale à la gloire du roi Louis XIV. Les travaux commencent en 1689. L’ancienne entrée fortifiée de la Porte du Peyrou est remplacée par un Arc de Triomphe en 1691.

Cette grande porte d’apparat de 15m de haut symbolise la puisse royale. L’arc donne sur un pont de pierre construit à la place de l’ancien pont-levis. Dans le prolongement, il y a la longue esplanade donnant sur la statue équestre de Louis XIV. La statue qui trône au centre de l’esplanade date de 1828. La statue originale, bien plus grande, a été détruite pendant la Révolution.


D’ailleurs, son arrivée à Montpellier ne s’était pas faite sans mal. Le navire qui transportait l’énorme statue en bronze de 19 tonnes a coulé à Bordeaux à cause de la foule de curieux! Il a fallu des mois pour repêcher la statue au fond du fleuve. Lors de son installation en 1718, Montpellier était la seule ville de France après Paris et Versailles à avoir l’honneur de posséder une représentation du roi.
La ville profite des grands travaux de l’esplanade pour construire l’aqueduc des Arceaux. Achevé en 1765, il permet enfin de capter l’eau de la source Saint-Clément et d’alimenter Montpellier en eau. L’architecte Pitot s’est inspiré du Pont du Gard pour la réalisation de ce pont-aqueduc de 900m de long. Il était encore utilisé jusqu’en 1983.

Si vous vous promenez au pied de l’aqueduc, vous pourrez voir une plaque commémorative. Elle marque l’endroit où a été prise en hiver 1939 la célèbre photo du futur résistant Jean Moulin avec son chapeau et son écharpe.
L’aqueduc s’achève sur une magnifique construction, le château d’eau du Peyrou (construit en 1768). Avec son bassin, il ressemble d’avantage à un temple antique. Et pourtant, sous ce bassin se trouve un grand réservoir premettant d’alimenter la ville.

Il faut absolument venir se promener sur l’esplanade du Peyrou pour profiter de la très jolie vue sur les Cévennes et le Pic Saint-Loup. C’est aussi un très bon spot pour les couchers de soleil. Tous les dimanches, l’esplanade laisse place aux brocanteurs et à la buvette 😉
Le Carré Sainte-Anne
En se promenant dans les ruelles, on arrive devant le plus haut monument de l’Ecusson. Le clocher de l’église Sainte-Anne culmine à 69m de hauteur et se voit de loin. Cette église néo-gothique a été construite en 1866 pour remplacer l’ancienne église qui menaçait de s’écrouler.


En 1986 elle est désacralisée. Maintenant c’est un centre culturel avec un grand espace d’exposition de 600m² dans la nef. Le Carré Sainte-Anne est ouvert gratuitement tous les jours sauf le lundi. Retrouvez plus d’infos sur les expositions en cours sur ce site.
Traversons maintenant la grande Rue Saint-Guilhem pour découvrir un nouveau monument de Montpellier.
L’église Saint-Roch
Au XIXe siècle, la ville veut construire une grande église monumentale dédiée à Saint Roch pour y accueillir quelques unes de ses reliques. Ce personnage est né à Montpellier au XIVe siècle dans une famille noble et riche. Le jeune homme distribue toute sa fortune aux pauvres et part en pèlerinage vers Rome. Grâce à ses études en médecine à Montpellier, il soigne de nombreux malades sur son chemin. Ces guérisons font rapidement sa renommée. Lui même survit miraculeusement à la peste! Sur le chemin du retour il est arrêté, on le prend pour un espion. Après cinq années de cachots, il meurt à l’âge de 30 ans. C’est seulement après sa mort qu’on découvre qu’il s’agissait du saint guérisseur. Son culte populaire se répand ensuite rapidement en France et en Italie. C’est le Saint Protecteur de la ville de Montpellier.


Son église est construite en 1868, dans un style néo-gothique, deux ans après celle de Sainte Anne, mais elle ne sera jamais totalement achevée. On voit bien que sur la façade il manque les deux flèches latérales ainsi que les statues qui devaient la décorer. Mais ce n’est pas grave car le quartier est cool 😉

Les ruelles colorées du quartier Saint-Roch sont remplies de terrasses de bars et de restaurants, de jolies boutiques. C’est vraiment un quartier animé et très sympa à découvrir dans Montpellier 🙂
La Tour de la Babote
En descendant la Rue du Plan d’Agde et la Rue de la Fontaine, on arrive sur le boulevard qui fait le tour du centre ville. Il marque l’emplacement des anciens remparts de Montpellier au XIIe siècle. La ville possédait alors 25 portes fortifiées. On en retrouve une à quelques pas d’ici, c’est la Tour de la Babote. Devenue inutile au XVIIIe siècle, on décide la préserver et même de la surélever pour y installer un observatoire d’astronomie. Elle est parfois ouverte aux visites lors des Journées du Patrimoine.


Info insolite : profitant de cet endroit, c’est depuis le haut de cette tour que le parachute a été inventé par Louis-Sébastien Lenormand en 1783 🙂 En réalité, il ne faisait des essais qu’avec des animaux. Le premier saut en parachute par un humain sera réalisé quelques années plus tard par Garnerin à Paris en 1797.
En suivant le boulevard, nous voici de retour à la gare. J’espère que cet article vous donnera envie d’aller vous plonger vous aussi dans les ruelles de cette très chouette ville 🙂
Un peu plus loin
Au nord de Montpellier on peut faire une balade dans la réserve naturelle du Lez à Lunaret. L’accès se fait par une grille au bout de la Rue de Ferran. Au programme, une belle promenade à l’ombre des arbres sur un sentier sauvage au bord du Lez.


Bonus, vous pourrez même découvrir une cascade! 🙂 Tout proche, vous pouvez aussi visiter le Zoo de Montpellier. Cerise sur le gâteau, ce grand parc zoologique en pleine nature est accessible gratuitement 😉 Plus d’infos sur ce site.
⚠️ Attention, ces sites sont fermés en cas de risque incendie très élevé ou alerte météo.